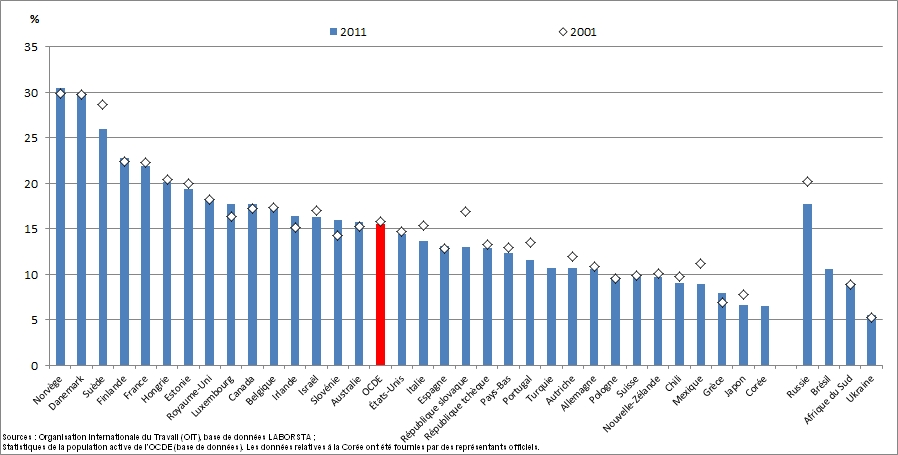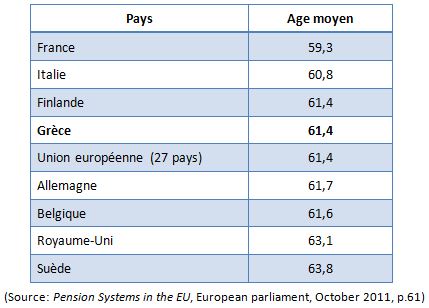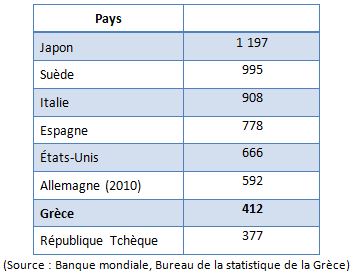Malgré des perceptions parfois contraires, les conseils d’administration des 50 plus grandes entreprises de Québec inc. en Bourse progressent « relativement bien » dans l’échelle des meilleures pratiques de gestion, constate-t-on dans un nouveau relevé effectué par l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP).
Entre autres, souligne le directeur général de l’IGOPP, Michel Nadeau, la présence des femmes à ces conseils affiche une « belle progression » en dépit d’un taux de roulement encore « un peu faible » d’une année à l’autre parmi l’ensemble des postes d’administrateur.
Aussi, selon M. Nadeau, la hausse de la rémunération moyenne des administrateurs d’entreprises, quoique significative sur quelques années, témoigne aussi des exigences rehaussées quant à leur implication et leur apport au bon fonctionnement du conseil dont ils sont membres.