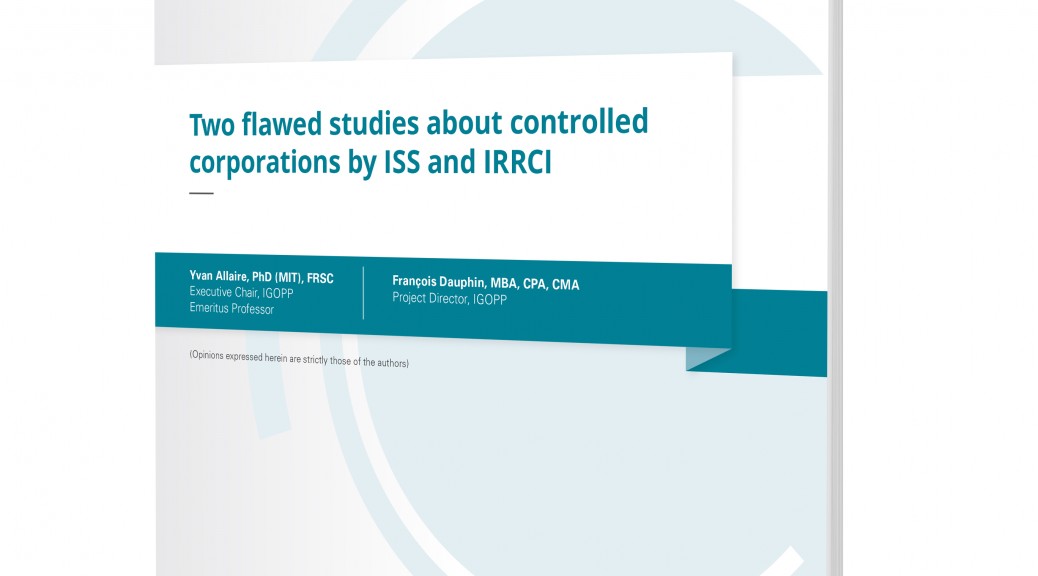« Le cri du coeur est venu cette semaine d’un cabinet de services comptables. PwC a dit s’inquiéter de la vision à court terme des actionnaires.
PwC faisait le bilan 2015 de l’industrie minière. Une année « caractérisée par une dégringolade générale ». Les 40 plus grandes sociétés minières ont enregistré collectivement une perte nette pour la première fois. Leur capitalisation boursière a fondu de 37 %, effaçant « tous les gains réalisés durant le supercycle des matières premières ». Le cabinet d’ajouter : « À l’échelle mondiale, on s’inquiète de la vision à court terme des actionnaires, qui se concentrent sur la variation des prix des matières premières et privilégient les rendements à court terme plutôt que l’horizon de placement à long terme indispensable dans le domaine minier. »
[ … ]
Il reste que le diktat de l’immédiat a la vie dure. Il se trouve pérenniser par une politique de rémunération des hauts dirigeants basée sur des indicateurs incitant à la performance à court terme. On pense à un bénéfice par action cible et à un objectif de rendement total pour l’actionnaire. Dans un texte publié au début de juin dans le quotidien français Le Monde, Yvan Allaire, président exécutif du conseil de l’institut sur la gouvernance (IGOPP), a donné en exemple ce choix des dirigeants empruntant la voie facile des rachats d’actions plutôt que de mettre à contribution les liquidités de l’entreprise dans des projets d’investissement et de développement à long terme. En jouant sur le dénominateur, on alimente une hausse du cours de l’action. Ou on compense l’effet de dilution venant de l’exercice d’options provoqué par cette hausse du cours.